Catégorie : Nos contributions.
-
Comme indiqué. -
Vers une Internationale sécessionniste.
La libération des formes artistiques a partout signifié leur réduction à rien.

Il ne reste que la trace, chez quelques créateurs modernes, d’une conscience traumatisée par le naufrage de l’expression comme sphère autonome.
L’œuvre fondamentale d’une sécession radicale doit être, avec la réactualisation de la critique, un nouvel essai de réponse aux exigences d’une communication créative de la part émancipée du vécu.
Dans un article inédit de 1947 (« Le matérialisme dialectique est-il une philosophie ? »), recueilli dans son livre Recherches dialectiques, Goldmann analysait très bien le résultat, dans l’avenir, du mouvement culturel qu’il avait sous les yeux, en écrivant : « … Comme le droit, l’économie ou la religion, l’art en tant que phénomène autonome séparé des autres domaines de la vie sociale, sera amené à disparaître dans une société sans classes. Il n’y aura probablement plus d’art séparé de la vie parce que la vie aura elle-même un style, une forme dans laquelle elle trouvera son expression adéquate. » Mais Goldmann, qui traçait cette perspective à très longue échéance en fonction des prévisions d’ensemble du matérialisme dialectique, n’en reconnaissait pas la vérification dans l’expression de son temps.Il jugeait l’écriture ou l’art de son temps en fonction de l’alternative classique–romantique, et il ne voyait dans le romantisme que l’expression de la réification.

Or, il est vrai que la destruction du langage, depuis un siècle de poésie, s’est faite en suivant la tendance romantique, réifiée, petite-bourgeoise, de la profondeur ; et, comme l’avait montré Paulhan dans Les Fleurs de Tarbes, en postulant que la pensée inexprimable valait mieux que le mot.
Mais l’aspect positif de cette destruction, dans la poésie, l’écriture romanesque ou tous les arts plastiques, c’est d’être en même temps le témoignage de toute une époque sur l’insuffisance de l’expression artistique. C’est d’avoir été la destruction pratique des instruments de cette pseudo-communication, posant la question de l’invention d’instruments supérieurs.
Il n’y a pas, pour les sécessionnistes du Spectacle, de possible retour en arrière. Le monde de l’expression qui s’y affiche, quel que soit son contenu, est définitivement périmé.Weirdcore. Le spectacle produit ici/nulle part la représentation de l’évasion impossible.
L’évasion comme représentation seulement.
La mémoire en miettes d’un vécu perdu se confond avec les restes indigestes de l’orgie spectacliste.
Le message est qu’on ne sort du spectacle que par et dans les égouts du spectacle, où se recycle le dégoût comme goût.
Le maintien ou la subversion de cette société n’est pas une question utopique : c’est la plus brûlante question d’aujourd’hui, celle qui contient toutes les autres.
Les créations de l’avenir devront modeler directement la vie, créant et généralisant les « instants exceptionnels » et c’est ce qu’il s’agit d’explorer.
La difficulté de ce saut était déjà mesurée par Goldmann quand il remarquait (dans une note de Recherches dialectiques, page 144) :
« Nous n’avons aucun moyen d’action directe sur l’affectif. »
C’est la tâche des créateurs d’une vie nouvelle d’inventer ces moyens, ce qui revient à la rendre intense et désirable.
La situation sera perçue comme le contraire de l’œuvre d’art, qui est un essai de valorisation absolue, et de conservation, du moment figé (ceci était l’épicerie fine esthétique d’un Malraux par exemple).
Le constructeur de situations, si l’on reprend un mot de Marx, « en agissant par ses mouvements sur la nature extérieure et en la transformant… transforme en même temps sa propre nature ».
Comme les prolétaires, théoriquement, devant la nation, les sécessionnistes campent aux portes de la culture en miettes congelées.Ils ne veulent pas s’y établir.
Bien sûr, le dépérissement des formes artistiques, s’il se traduit par l’impossibilité de leur renouvellement créatif, n’entraîne pas encore leur véritable disparition pratique. Elles peuvent encore spectaculairement se répéter, sous assistance artificielle.- Ce qui porte le nom d’art contemporain est un composé de publicité, de finance spéculative et de bureaucratie culturelle.
Jaime Semprun.
Mais, pour parler comme Hegel dans la préface de la Phénoménologie de l’Esprit : « La frivolité et l’ennui qui envahissent ce qui subsiste encore, le pressentiment vague d’un inconnu sont les signes annonciateurs de quelque chose d’autre qui est en marche. »
Nous devons aller plus loin, sans nous attacher à rien de ladite culture moderne, et non plus de sa négation. Nous ne voulons pas travailler au spectacle de la fin d’un monde, mais à la fin du monde du spectacle.
Détourné de Internationale situationniste n° 3, décembre 1959.
- Ce qui porte le nom d’art contemporain est un composé de publicité, de finance spéculative et de bureaucratie culturelle.
-
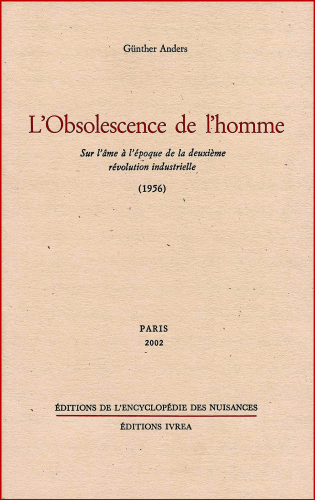
L’obsolescence de l’homme, de Günther Anders, scandaleusement « ignorée » en France pendant plus de 50 ans, demeure en 2024 une œuvre encore largement méconnue, sans que l’on puisse savoir s’il s’agit d’un silence intéressé ou de l’un des effets de l’ablation universelle de l’attention, dont ce texte nous livre l’accablant diagnostic.
Anders mène une enquête sur l’état de l’humanité face aux forces proprement impensables qu’elle a déchaînées. L’hubris technologique a produit la bombe atomique, dont l’auteur note que les conséquences, littéralement, dépassent l’entendement.
Mais ce qu’il nous décrit est pire : à savoir que cette démesure industriellement suréquipée est elle-même une nouvelle sorte de bombe, et même la bombe ultime, capable d’exploser l’humanité tout en conservant ses apparences :
« L’effacement, l’abaissement de l’homme en tant qu’homme réussissent d’autant mieux qu’ils continuent à garantir en apparence la liberté de la personne et les droits de l’individu. Chacun subit séparément le procédé du « conditioning », qui fonctionne tout aussi bien dans les cages où sont désormais confinés les individus, malgré leur solitude, malgré leurs millions de solitudes. Puisque ce traitement se fait passer pour « fun » ; puisqu’il dissimule à sa victime le sacrifice qu’il exige d’elle ; puisqu’il lui laisse l’illusion d’une vie privée ou tout au moins d’un espace privé, il agit avec une totale discrétion. »
Lancé « à la recherche de la vie perdue », cet essai en rencontre l’expression achevée sous la forme du « dividu », soit l’individu en morceaux, auto-divisé et autoentrepreneur de sa propre dispersion : « l’homme d’aujourd’hui, [qui] est lui aussi un produit (dans la mesure où il est au moins le produit de sa propre production, une production qui l’altère totalement et imprime en lui, en tant que consommateur, l’image du monde produit industriellement et la vision du monde qui lui correspond). »
L’auteur pourra encore noter que « aujourd’hui, une âme coupée en deux est un phénomène quotidien. C’est même le trait le plus caractéristique de l’homme contemporain, tout au moins dans ses loisirs, que son penchant à se livrer à deux ou plusieurs occupations disparates en même temps (…). L’homme qui prend un bain de soleil, par exemple, fait bronzer son dos pendant que ses yeux parcourent un magazine, que ses oreilles suivent un match et que ses mâchoires mastiquent un chewing-gum. Cette figure d’homme-orchestre passif et de paresseux hyperactif est un phénomène quotidien et international » (le « magazine » a été depuis avantageusement remplacé par le Smartphone).
Si, en 1967, Debord a exposé, sous une forme hégélienne-marxienne, les mécanismes de la société du spectacle, Anders l’avait déjà soumise, 11 ans plus tôt (ce que Debord semble avoir eu du mal à admettre), à une implacable enquête phénoménologique.
C’était bien déjà cette passivité propre au spectateur que décrivait Anders : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuir le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde en effigie. »
Et parmi ces effigies, trônent nécessairement les vedettes, dont Debord notera que c’est le besoin qu’on a d’elles, la misère de ce besoin, qui les fait vedettes, ce qu’Anders exprime tout aussi rigoureusement :
« Il est on ne peut plus logique que ceux d’entre nous qui réussissent de la façon la plus spectaculaire à avoir de multiples existences (et à être vus par plus de gens que nous, le commun des mortels), c’est-à-dire les stars de cinéma, soient des modèles que nous envions. La couronne que nous leur tressons célèbre leur entrée victorieuse dans la sphère des produits de série que nous reconnaissons comme « ontologiquement supérieurs ». C’est parce qu’ils réalisent triomphalement notre rêve d’être pareils aux choses, c’est parce qu’ils sont des parvenus qui ont réussi à s’intégrer au monde des produits, que nous en faisons des divinités. »
L’auteur poursuit en décrivant précisément cette intégration :
« Il n’y a plus aucune différence ontologique essentielle entre la star de cinéma disséminée dans les milliers de copies de ses films et le vernis à ongles réparti pour être vendu dans des milliers de flacons.
Il est on ne peut plus logique que, dans la réclame, la star et la marchandise de masse se soutiennent mutuellement (la star en recommandant la marchandise, la marchandise en accueillant des images de la star sur son emballage) et s’allient : « Qui se ressemble s’assemble. »
Ce qui est vrai des marchandises, des vedettes, des marchandises vedettes et des vedettes-marchandises l’est aussi, comme par ruissellement dirait-on aujourd’hui, des citoyens des cités d’illusion (« quand le fantôme devient réel, c’est le réel qui devient fantomatique »), et de la même façon, qui les rend pareillement étrangers : « C’est seulement par mégarde qu’ils peuvent encore se voir, se regarder ; c’est seulement par hasard qu’ils peuvent encore se parler (à condition qu’ils le veuillent ou le puissent encore). Ils ne sont plus ensemble mais côte à côte ou, plus exactement, juxtaposés les uns aux autres. Ils sont de simples spectateurs. »
Mais spectateurs de quoi ? De n’importe quoi à portée de nos doigts fébriles ou frénétiques, qui puisse nous divertir – au sens pascalien – de nos vies fantomatiques ; de ces milliards d’existences occupées – au sens militaire – à produire et consommer des fantômes (« nous devenons des voyeurs exerçant leur domination sur un monde fantôme »), c’est-à-dire des mensonges en veux-tu en voilà ; alimentaires, diététiques, médiatiques, politiques, électriques, névrotiques toujours : « il est inutile d’arranger après coup de fausses visions du monde, des visions qui diffèrent du monde, des idéologies, puisque le cours du monde lui-même est déjà un spectacle arrangé. Mentir devient superflu quand le mensonge est devenu vrai. »
Debord aurait pu écrire : « quand le monde n’a d’importance sociale que sous forme de reproduction, c’est-à-dire en tant qu’image, la différence entre être et paraître, entre réalité et image, est abolie. Quand l’événement sous forme de reproduction prend socialement le pas sur sa forme originale, l’original doit alors se conformer aux exigences de la reproduction et l’événement devenir la simple matrice de sa reproduction », et cela encore Anders l’avait déjà noté.
De même, il n’y a maintenant plus qu’un seul mot à changer pour qu’il ait également noté que « rien ne nous aliène à nous-mêmes et ne nous aliène le monde plus désastreusement que de passer notre vie, désormais presque constamment, en compagnie de ces êtres faussement intimes, de ces esclaves fantômes que nous faisons entrer dans notre salon d’une main engourdie par le sommeil – car l’alternance du sommeil et de la veille a cédé la place à l’alternance du sommeil et de l’internet (…). Rien ne rend l’auto-aliénation plus définitive que de continuer la journée sous l’égide de ces apparences d’amis : car ensuite, même si l’occasion se présente d’entrer en relation avec des personnes véritables, nous préférerons rester en compagnie de nos portable chums, nos copains portatifs, puisque nous ne les ressentons plus comme des ersatz d’hommes mais comme nos véritables amis », et souvent même nos coachs aussi, puisqu’il « est presque inutile de rappeler que d’innombrables girls réelles se sont donné l’apparence d’images de cinéma et courent çà et là comme des reproductions de reproductions, parce que si elles se contentaient d’être elles-mêmes, elles ne pourraient pas rivaliser avec le sex-appeal des fantômes et seraient, de la manière la moins fantomatique qui soit, reléguées dans l’ombre, c’est-à-dire ramenées dans la dure réalité. »
La dure réalité, c’est d’en éprouver les ruines, le gris, les débris, le vide et l’ennui. C’est de se faire une sensibilité pour de vrai, ce contre quoi ce monde ne tiendrait pas une heure de plus, si elle se généralisait. La représentation, sous ses dehors hypnotiques, est avant tout une anesthésie planétaire.
Lecture d’un extrait de ce texte. Comme le remarque encore Anders : « Qui a déjà eu l’occasion de regarder une course automobile qui, sur l’écran de télévision, a l’air d’une course de modèles réduits a pu constater ensuite, incrédule, que l’accident mortel auquel il a alors assisté ne l’a, en réalité, guère affecté. Certes, on sait bien que ce à quoi l’on vient d’assister vient réellement d’arriver au moment même où on l’a vu sur l’écran de télévision ; mais on le sait seulement. »
Pour une humanité ainsi éduquée, il devait fatalement devenir tout aussi vrai que l’écran deviendrait total ; qu’il recouvrirait inexorablement toute la réalité, de sorte que « ce n’est pas la véritable place Saint-Marc, celle qui se trouve à Venise, qui est « réelle » pour [les touristes] mais celle qui se trouve dans leur album de photos à Wuppertal, Sheffield ou Detroit. Ce qui revient à dire que ce qui compte pour eux n’est pas d’y être mais d’y être allé. » Il est donc ici aisé de conclure que « l’intention de la livraison d’images, de la livraison de l’image totale du monde », était bien dès le début des temps spectaculaires, « de recouvrir le réel à l’aide du prétendu réel lui-même et donc d’amener le monde à disparaître derrière son image. »

Une première version de ce texte a été publiée en 2023 sur le site Contrelittérature. Celle-ci est une reprise légèrement modifiée.
-
Une fois n’est pas coutume, nous souhaiterions attirer l’attention sur cet éditeur exceptionnel, avec lequel nous avons préparé la parution en septembre 2024 de notre prochain livre, Remède à tout.

Quiero est un acte amoureux. Formé par Jean-Claude Bernard, maître typographe et imprimeur, Samuel Autexier pratique la technique typographique : un rapport différent au temps, en raison de la lenteur du procédé, qui nécessite de bien prévoir la composition du texte, donnant un tout autre poids au travail d’édition.
Nous avons pu de notre côté apprécier semaines après semaines, en révisant ensemble notre manuscrit, la rigueur, l’exigence et le soin que met Samuel Autexier dans ce qu’il entreprend.
Ce livre de 150 pages ne serait sans doute pas tout à fait ce qu’il est sans les remarques, suggestions et propositions que l’éditeur nous a faites, presque ligne à ligne.
Comme pour tout « petit » éditeur aujourd’hui, la poursuite de ses activités dépend aussi de la sympathie active des lectrices et des lecteurs.
Nous vous proposons de consulter la page de souscription récemment publiée, qui propose les formules suivantes :
Soutien simple : 20 euros (avec un livre à choisir parmi les parutions 2024).
Soutien sympathique : 60 euros (avec trois livres à choisir dans la liste).
Soutien soutenu : 100 euros (avec les cinq livres à paraître).Pour faire votre choix, si le cœur vous en dit, veuillez consulter le très beau et riche Catalogue 2024.
Parmi ces titres, vous trouverez donc aussi le nôtre, que vous pouvez ainsi d’ores et déjà réserver.

Photo prise pendant la composition du livre de Guy Lévis Mano Trois typographes en avaient marre dans l’atelier d’Archétype à Forcalquier. PS. Pour notre part, nous avons une attirance insistante pour un ouvrage paru en 2023, qui est toujours disponible :

-
Le temps nous sépare du renouvellement infini de l’instant, qui est la vie comme tout enfant non contrarié la vit.
Il n’y a pas d’autre temps que le temps d’organiser la mort à vivre.
Cette organisation, c’est le temps de la production et de l’illusoire compensation de la consommation.
Le renouvellement de l’instant disparaît sous le décompte des heures.
La vie se meurt et la valeur prend sa place.
L’argent fixe la valeur de la vie.
L’argent fixe la vie comme valeur.
L’argent est la valeur à la place de la vie.
Le temps c’est de l’argent et l’argent, l’éternité volée à la vie.
Time separates us from the infinite renewal of the moment, which is life as any undisturbed child experiences it.
There is no time other than the time to organize death to live.
This organization is the time of production and the illusory compensation of consumption.
The renewal of the moment disappears beneath the counting of the hours.
Life dies and value takes its place.
Money sets the value of life.
Money sets life as a value.
Money is the value instead of life.
Time is money and money is eternity stolen from life. -
There are lots of knots and we need to find the end of the string. From there, we can patiently untangle the whole. This end is the development of individual consciousness, its emancipation, its elevation, its autonomy, its freedom; the joys that result, the solutions it foresees, their creative and evolutionary sharing. This is the cornerstone, the rock on which everything else is built.
Yet the entire system of planetary domination, whether it’s the stultification of alienated, forced labor or the consumerist stupidity that is its counterpart, is designed to deprive individuals of this emancipated conscious development.
Instead, these individuals are « invited » to take their place as cogs in the system, not just superficially, but in ever-greater mimetic dependence. The aim: to calculate one’s existence, to think in algorithms, to make oneself indispensable to the artificial.
Hence the human-shaped shop windows that stroll along what’s left of the sidewalks, and the omnipresent background sounds of walking cash drawers.
The society of the spectacle no longer looks much like a society, while the spectacle turns into a tragic comedy.
It’s in the midst of this battlefield, mined on all sides and in a thousand ways, that we have to decide how to get out of it, which is all the more difficult given that, at first glance, there’s nowhere else to go.
Except the emancipated space of emancipatory consciousness. The end of the ball.
It is from here, and only here, that humanity can glimpse not a rebirth, but rather, its true birth.
Only then is it useful, legitimate and possible to progressively redesign – at the pace of the emancipated evolution of emancipated consciousnesses – the relationships that humanity can maintain or allow to wither or abolish with technology, with knowledge, with tools, instruments, machines, with the hands, with the heart, with inspirations, intuitions, the sense of what is true, good, beautiful, just, with the taste for life, the flowering and harvesting of its joys, the overcoming of its sorrows and the horizons of its destiny, among others.
Only from there, and not from ideologies, systems (even anti-system ones), postulates, dogmas, still less from impositions, decrees or ready-made solutions.
Nor from democracy, however small-scale and direct. A democracy of morons or barbarians or of moronic barbarians, or of mimetic or sclerotic, sectarianized individuals, will produce micro-barbaries, or sects, and so on. Representative democracy, which is certainly a sham, is not the cause of the passivity of the masses, but it is the passivity of individual consciences agglutinated in masses that makes it possible.
As long as these individual consciences remain passive, they will agglutinate in masses, even if they are small masses: 20, 100, 500 zombies gathered in a direct democracy will give nothing more than a more direct – and certainly democratic – access to zombitude.
At the moment, we can’t really decide whether to use a part of democracy, a part of representativeness, a part of industry, a part of machines, why or how. All this, and everything else, depends on the relationship that each and every one of us, in fairly significant numbers, will have with ourselves, with our thoughts, our desires, our hearts, our hands, our loved ones, our distant ones, non-humans (if that makes any sense), the earth, our perception of it, the way we care for it, help it, participate in it, take what is necessary from it, and so on.
We can only reasonably envisage that it will take time, debunkings, reconversions, abolitions, alchemies, evolutions, bifurcations, against a backdrop of communicative wisdom – which is the emancipatory development of individual consciences becoming emancipated.

Il y a un grand nombre de nœuds et il nous faut trouver le bout de la ficelle. De là, nous pourrons patiemment démêler le tout. Ce bout, c’est le développement de la conscience individuelle, son émancipation, son élévation, son autonomie, sa liberté ; les joies qui en résultent, les solutions qu’elle entrevoie, leur partage créatif et évolutif. C’est la pierre angulaire, le roc sur lequel édifier tout le reste.
Or l’ensemble du système de domination planétaire, qu’il s’agisse de l’abrutissement du travail aliéné et contraint ou de l’abêtissement consumériste qui en est le pendant, est fait pour priver les individus de ce développement conscient émancipé.
A la place, ces individus sont « invités » à prendre place en tant que rouages de ce système, non pas seulement superficiellement, mais dans une dépendance mimétique toujours plus forte. : calculer son existence, penser par algorithmes, se rendre indispensable à l’artificiel.
D’où ces vitrines à forme humaine qui déambulent sur ce qui reste de trottoirs, ce fond sonore omniprésent de tiroirs-caisses ambulants.
La société du spectacle ne ressemble plus trop à une société, tandis que le spectacle tourne à la comédie tragique.
C’est au milieu de ce champ de bataille miné de toutes parts et de mille façons qu’il faudrait décider de comment en sortir, ce qui est d’autant moins évident qu’il n’y a de prime abord aucun ailleurs où sortir.
Sauf l’espace émancipé de la conscience émancipatrice. Le bout de la pelote.
C’est à partir de là et seulement de là que l’humanité peut entrevoir non pas une renaissance mais mieux, sa véritable naissance.
C’est seulement à partir de là qu’il est utile, légitime, possible de redessiner progressivement – au rythme de l’évolution émancipée des consciences émancipées – les relations que l’humanité peut entretenir ou laisser dépérir ou abolir avec la technique, avec le savoir, avec les outils, les instruments, les machines, avec les mains, avec le cœur, avec les inspirations, les intuitions, le sens du vrai, du bien, du beau, du juste, avec le goût de vivre, la floraison et la moisson de ses joies, le dépassement de ses peines et les horizons de sa destinée, entre autres.
A partir de là seulement, et non pas à partir d’idéologies, de systèmes (fussent-ils antisystèmes), de postulats, de dogmes, encore moins d’impositions, de décrets, de solutions toutes faites.
Pas plus à partir de la démocratie, fut-elle directe et à échelle réduite. Une démocratie d’abrutis ou de barbares ou de barbares abrutis, ou d’individus mimétiques ou sclérosés, sectarisés, produira de micro-barbaries, ou des sectes, etc. La démocratie représentative, qui est certes une imposture, n’est pas la cause de la passivité des masses, mais c’est la passivité des consciences individuelles agglutinées en masses qui la rend possible.
Tant que ces consciences individuelles resteront passives, elles s’agglutineront en masse, fussent-elles de petites masses : 20, 100, 500 zombies rassemblés en démocratie directe ne donneront rien d’autre qu’un accès plus direct – et démocratique certes – à la zombitude.
Nous ne pouvons actuellement véritablement décider si, ponctuellement, une part de démocratie pourrait être utilisée, voire ponctuellement une part de représentativité, une part d’industrie, une part de machines, pourquoi, comment. Tout cela, et tout le reste, est suspendu à la relation que chacune et chacun, en nombre assez significatif, entretiendra avec soi-même, avec ses pensées, ses désirs, son cœur, ses mains, ses proches, ses lointains, les non-humains (si cela garde un sens), la terre, la perception qu’on en a, la façon de l’entretenir, de l’aider, d’y participer, d’en prélever ce qui est nécessaire, etc.
Nous pouvons seulement envisager raisonnablement qu’il faudra du temps, des déboulonnages, des reconversions, des abolitions, des alchimies, des évolutions, des bifurcations, sur fond de sagesse communicative – ce qui relève du développement émancipateur des consciences individuelles s’émancipant.
